 Experience du cerf-volant
de
Benjamin Franklin
.
Experience du cerf-volant
de
Benjamin Franklin
.
Les
methodes experimentales
scientifiques
consistent a tester la validite d'une
hypothese
, en reproduisant un phenomene (souvent en laboratoire) et en faisant varier un parametre. Le parametre que l'on fait varier est implique dans l'hypothese. Le resultat de l'experience valide ou non l'hypothese. La demarche experimentale est appliquee dans les recherches dans des sciences telles que, par exemple, la
biologie
, la
physique
, la
chimie
, l'
informatique
, la
psychologie
, ou encore l'
archeologie
.
Definies par le
chimiste
Michel-Eugene Chevreul
en 1856, elles ont ete developpees par
Claude Bernard
en
medecine
et en
biologie
. Outil privilegie des
sciences de la nature
, les methodes experimentales sont egalement utilisees en
sciences humaines et sociales
.
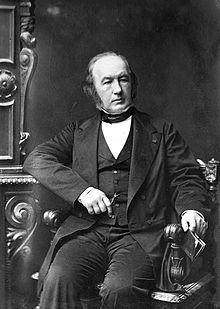 Claude Bernard
Claude Bernard
La methode experimentale est ainsi definie par le chimiste
Michel-Eugene Chevreul
en 1856 :
≪ Un phenomene frappe vos sens ; vous l’observez avec l’intention d’en decouvrir la cause, et pour cela, vous en supposez une dont vous cherchez la verification en instituant une experience. Le
raisonnement
suggere par l'observation des phenomenes institue donc des experiences (…), et ce raisonnement constitue la methode que j’appelle experimentale, parce qu’en definitive l’experience est le controle, le criterium de l’exactitude du raisonnement dans la recherche des causes ou de la verite ≫
[
1
]
.
Cette methode a ete centrale dans la
revolution scientifique
accomplie depuis le
XVII
e
siecle, en donnant naissance aux sciences experimentales. Parmi les precurseurs de la methode experimentale, il convient de citer le
physicien
et
chimiste
irlandais
Robert Boyle
, qui est aussi le pere de la
philosophie naturelle
, ainsi que le
medecin
Claude Bernard
.
Georges Canguilhem
[
2
]
et
Jean Gayon
[
3
]
relevent la dette de Claude Bernard envers les theses
methodologiques
de Chevreul, liee au
≪ dialogue ininterrompu entre les deux maitres du Museum ≫
[
4
]
, dette que le
physiologiste
reconnait d'ailleurs des l'introduction de son ouvrage majeur :
≪ de nos jours, M. Chevreul developpe dans tous ses ouvrages des considerations tres importantes sur la philosophie des sciences experimentales. (…) Notre unique but est et a toujours ete de contribuer a faire penetrer les principes bien connus de la methode experimentale dans les sciences medicales ≫
[
5
]
.
Claude Bernard distingue nettement les approches
empiriques
et experimentales :
≪ L'empirisme est un donjon etroit et abject d'ou l'esprit emprisonne ne peut s'echapper que sur les ailes d'une hypothese ≫
[
6
]
. Il insiste en effet sur l'importance de l'hypothese, et Canguilhem qualifie l'
Introduction a l’etude de la medecine experimentale
de
≪ long plaidoyer pour le recours a l’idee dans la recherche, etant entendu qu’une idee scientifique est une idee directrice et non une idee fixe ≫
[
7
]
. Les etapes de la methode experimentale ont ete resumees par le sigle
OHERIC
, schema tres simplificateur, et des
modeles plus proches d'une methode experimentale authentique
ont ete proposes.
Le schema de la verification d’une hypothese a l’aide de l’experience est demeure en vigueur dans les
sciences experimentales
de
Francis Bacon
jusqu’au
XX
e
siecle, date a laquelle certains l'ont remis en cause (
Pierre Duhem
en 1906
[
8
]
). En effet, selon l'article de
Quine
≪
Deux dogmes de l'empirisme
≫, il n'existe aucune
≪ experience cruciale ≫
qui puisse permettre de confirmer, ou non, un enonce scientifique. Quine soutient en effet une position
holiste
, qui ne denie pas tout role a l'experience, mais considere que celle-ci ne se rapporte pas a un enonce scientifique, ou hypothese, en particulier, mais a l'ensemble de la
theorie scientifique
. Aussi, a chaque fois qu'une experience semble apporter un dementi a l'une de nos hypotheses, nous avons en fait toujours le choix entre abandonner cette hypothese, ou la conserver, et modifier, a la place, un autre de nos enonces scientifiques. L'experience ne permet pas, ainsi, d'infirmer ou de confirmer une hypothese determinee, mais impose un reajustement de la theorie, dans son ensemble. Nous avons toujours le choix de proceder au reajustement que nous preferons :
≪ On peut toujours preserver la verite de n'importe quel enonce, quelles que soient les circonstances. Il suffit d'effectuer des reajustements energiques dans d'autres regions du systeme. On peut meme en cas d'experience recalcitrante preserver la verite d'un enonce situe pres de la
peripherie
, en alleguant une
hallucination
, ou en modifiant certains des enonces qu'on appelle lois logiques. Reciproquement (…), aucun enonce n'est a tout jamais a l'abri de la revision. On a ete jusqu'a proposer de reviser la loi logique du
tiers exclu
, pour simplifier la
mecanique quantique
≫
[
9
]
.
Wolfgang Kohler
constate que
≪ les physiciens ont mis des siecles a remplacer graduellement des observations directes et surtout qualitatives par d'autres, indirectes, mais tres precises ≫
[
10
]
. Il cite quelques exemples ou tel savant fait une observation singuliere mais uniquement d'ordre qualitatif avant que ce fait - une fois decouvert - serve de fondement a une methode d'evaluation quantitative du phenomene ; ces methodes se concretisent souvent en
instruments de mesure
toujours plus perfectionnes.
Il generalise ce constat historique en posant que toute nouvelle science se developpe naturellement par le passage progressif des ≪ experiences directes et qualitatives ≫ aux ≪ experiences indirectes et quantitatives ≫, celles-ci etant une caracteristique majeure des
sciences exactes
. Il insiste sur la necessaire accumulation prealable des experiences essentiellement qualitatives ; conditions indispensables des investigations quantitatives ulterieures.
C'est le defi qu'il propose a la psychologie qu'il considere comme une ≪ jeune science ≫. Il invite ainsi a resister a l'imitation de la physique, a ne pas plaquer les methodes d'une science mure sur les tatonnements de celle qui se cherche et donc a favoriser avant tout la croissance des experimentations qualitatives prealables indispensables aux futures experiences quantitatives rigoureuses.
Reconnaissant la complexite de l'objet de la
psychologie comparee
aux simplifications que la physique autorise, il assure apres avoir evoque la question des
tests
qu'
≪ on ne saurait assez souligner l'importance de l'information qualitative comme complement necessaire du travail quantitatif ≫
. L'exemple type est celui de
Galilee
, qui decouvre le
mouvement des planetes
par l'observation avec une
lunette astronomique
.
Controle des parametres et test d'hypotheses
[
modifier
|
modifier le code
]
La methode experimentale repose sur un principe : il s'agit de modifier un ensemble de parametres a l'aide d'un dispositif experimental concu pour permettre le controle de ces parametres, dans le but de mesurer leurs effets et si possible de les modeliser. Dans le cas le plus simple on cherche a modifier un seul parametre a la fois,
≪ toutes choses egales par ailleurs ≫
. Cependant il n'est pas toujours possible ni souhaitable de modifier un seul parametre a la fois. Ainsi en chimie lorsqu'on opere sur les constituants d'une seule phase (
liquide
,
solide
,
gazeuse
ou sous forme de
plasma
) la somme des concentrations des constituants reste egale a un ; modifier la valeur de l'une d'entre elles modifie inevitablement la concentration d'un autre constituant au moins. D'autres fois le resultat d'une experimentation portant sur un seul facteur peut induire une conclusion erronee. Ainsi le resultat recherche peut etre nul pour certaines conditions fixees et se reveler important lorsque les conditions fixees sont differentes. Ce cas traduit l'existence de ≪ synergie ≫ ou ≪ d'interaction ≫ entre des facteurs (Voir la comparaison de plans en etoile et de plans factoriels, Linder
p.
38). Cet enjeu est parfois crucial (cas des synergies entre des medicaments, entre des polluants, etc.). Le plus souvent on cherche a tester une
hypothese
portant sur une liaison cause-consequence. Dans l'analyse des resultats (la qualite de cette liaison) les statistiques jouent un role tres important aussi bien pour porter un jugement (sur la precision du modele previsionnel obtenu) que pour concevoir une experimentation optimale par rapport au risque statistique (Linder,
p.
126). Considerons l'exemple suivant a un seul parametre dont l'objectif est de tester l'hypothese suivant laquelle
≪ la lumiere permet la croissance d'une
plante
≫
. Dans l'exemple propose, differentes plantes seront soumises a des eclairages differents, toutes choses egales par ailleurs, notamment la temperature doit rester fixe et donc independante de l'eclairage, afin de mesurer l'impact de ce parametre sur leur croissance.
L'experience consiste a reproduire le phenomene ≪ croissance d'une plante ≫ de deux manieres :
- d'une part sans le parametre a tester (sans lumiere) ; c'est le
temoin
negatif.
- d'autre part, un
temoin
positif, avec le parametre a tester (avec lumiere). Ce dernier dispositif permet de verifier que tous les autres elements non testes sont operationnels (la plante fonctionne bien).
Avant meme la mise en œuvre, les resultats de l'experience doivent etre prevus :
- si la croissance ne se produit pas dans les deux dispositifs, je ne peux rien deduire si ce n'est que ma manipulation n'est pas adaptee a ma recherche ;
- si la croissance ne se produit pas sans lumiere, mais avec la lumiere alors l'hypothese est validee : ≪ la lumiere fait pousser les plantes ≫ ;
- si la croissance ne se produit pas avec lumiere, mais sans la lumiere, alors l’hypothese est refutee ;
- si le phenomene se produit dans les deux dispositifs, alors l'hypothese n'est pas validee, mais elle n'est pas rejetee pour autant.
En dehors du parametre a tester qu'il faut faire varier, les autres parametres susceptibles d'intervenir doivent etre fixes de facon rigoureuse sinon ≪ le mieux possible ≫. A defaut, ces parametres risquent d'etre a l'origine des differences de resultats entre l'experience temoin et les autres. Par exemple, s'il fait ≪ trop froid ≫ dans le premier dispositif sans lumiere ou si l'atmosphere ne contient ≪ pas assez ≫ de gaz carbonique, alors l'absence de croissance peut etre due a ces facteurs. On voit aussi la necessite d'un savoir scientifique le plus large possible pour permettre la bonne conception d'une experimentation.
La conduite d'une experience mene ainsi le schema d'interpretation
epistemologique
classique a deux types de benefice :
- d'abord la possibilite de
verifier
ou, mieux, de corroborer l'hypothese ou de la
refuter
;
- mais aussi dans tous les cas, un enseignement sur les causes de l'eventuel echec, enseignement qui sera reinvesti dans la definition d'une experience plus adequate. Le benefice est alors methodologique.
Experience scientifique a l'aide de modele
[
modifier
|
modifier le code
]
 L'espece
Mus musculus
, un exemple d'
organisme modele
L'espece
Mus musculus
, un exemple d'
organisme modele
Lorsque certains phenomenes naturels sont trop complexes, trop vastes, trop dangereux, trop chers ou trop long a reproduire dans une experience, on a recours a un dispositif simplifie : le
modele
.
Il peut s'agir :
Dans ce cas, la validite du modele peut etre discutee. Un modele doit representer le mieux possible l'objet sur lequel repose une hypothese. Par exemple, pour demontrer l'origine humaine du
rechauffement climatique
, on utilise des
modeles numeriques du climat
. Les detracteurs de cette hypothese remettent en cause ces modeles qui ne prendraient pas assez en compte l'influence des
nuages
.
Le protocole d'experimentation regroupe la
description
des conditions et du deroulement d'une
experience
ou d'un test. La description doit etre suffisamment claire afin que l'experience puisse etre reproduite a l'identique et il doit faire l'objet d'une analyse critique pour notamment detecter d'eventuels biais.
D'un point de vue tres general, l'experience isolee comporte sommairement trois phases :
- la preparation ;
- l'experimentation ;
- l'evaluation.
Les deux dernieres sont l'aboutissement simple de ce qui les a precede.
Une experience globale composee d'experiences partiellement individualisables comporte les trois memes poles. Cependant, si dans l'experience isolee les trois phases constituent autant d'etapes reglees
chronologiquement
, dans l'experience globale, il s'agit de trois registres qui
interagissent
en permanence. Ainsi :
- l'evaluation est plus ou moins associee aux parametres pris en compte dans la preparation, par exemple, les resultats questionnent la methode d'echantillonnage ;
- l'experimentation peut etre repetee, en fonction des deux autres phases ;
La preparation se realise autour d'une double intention : la reussite de l'experience, c'est-a-dire la conduite jusqu'a son terme ; la pertinence ou succes de l'experience, c'est-a-dire l'acces a un resultat positif, a l'egard de l'objectif initial. Chacune des intentions motivant et organisant l'experience trouve ses limites dans au moins une forme d'incertitude : l'incertitude de base portant sur la realisation de l'experience est rejointe par autant d'incertitudes qu'il y a de choix possibles pour les conditions initiales.
La preparation est donc basee sur des perspectives et operations d'
anticipation
; supputations de l'experience qui peuvent reduire l'incertitude sur tel ou tel parametre. La preparation aboutit ainsi a la reunion de
facteurs
d'efficacite. Dans l'experience globale, chaque phase ne resultant pas simplement de la precedente, les liens entre les conditions initiales et les resultats sont affectes par une complexite qui apporte une nouvelle charge d'incertitude. L'evaluation se refere a des criteres qui auront ete explicites en association avec la determination des facteurs d'efficacite.
 Exemple d'experience en blocs aleatoires complets relative a la comparaison de six elements (par exemple six fumures differentes, numerotees de 1 a 6) au sein de quatre blocs.
Exemple d'experience en blocs aleatoires complets relative a la comparaison de six elements (par exemple six fumures differentes, numerotees de 1 a 6) au sein de quatre blocs.
Dans les experiences en champ au sens large (champ, verger, foret, etc.), qui sont realisees en recherche
agronomique
, on appelle ≪ blocs ≫ des ensembles de
parcelles
voisines qui servent a comparer differents traitements (differentes
fumures
par exemple). Les blocs sont dits ≪ complets ≫ quand tous les elements qui interviennent dans l'experience (toutes les fumures etudiees par exemple) y sont presents. Ils sont au contraire dits ≪ incomplets ≫ quand seulement certains de ces elements y sont presents.
La repartition des differents elements est realisee au hasard a l'interieur des differents blocs, et independamment d'un bloc a l'autre, raison pour laquelle les blocs sont souvent qualifies d'≪ aleatoires ≫ ou ≪ randomises ≫. Le cas le plus frequent est celui des experiences en ≪ blocs aleatoires complets ≫ ou ≪ blocs randomises complets ≫ (cf. illustration). Le
carre latin
et le
carre greco-latin
sont d'autres dispositifs experimentaux, beaucoup moins utilises que les blocs.
L'utilisation de blocs (en anglais :
blocking
) intervient egalement, parfois sous d'autres denominations, dans d'autres domaines que l'experimentation en champ et la recherche agronomique (recherche industrielle ou technologique,
recherche medicale
ou pharmaceutique, etc.). En matiere medicale par exemple, les blocs peuvent etre constitues de groupes de patients qui presentent des caracteristiques semblables.
Instruments frequemment utilises en sciences experimentales
[
modifier
|
modifier le code
]
Les methodes de
microscopie
sont utilisees principalement en sciences de la matiere et de la vie :
sciences des materiaux
,
biologie moleculaire
,
geologie
… mais aussi pour les investigations :
police scientifique
,
epidemiologie
et
diagnostic medical
(
culture de cellules
), etudes environnementales (hygiene et securite du travail, pollution)…
Ces methodes consistent a determiner la structure des
cristaux
et des
molecules
. Elles sont utilisees en
chimie analytique
, pour etudier la synthese des molecules (
synthese organique
,
industrie pharmaceutique
), en
sciences des materiaux
…
De nombreux domaines ont recours a la
chimie analytique
.
Les
essais mecaniques
ont pour role de determiner la capacite d'un materiau ou d'une structure complexe a se deformer (mise en forme,
usinage
,
rheologie
), a s'user (
tribologie
), ou a casser. Cela concerne bien sur les
sciences des materiaux
, mais aussi la
biomecanique
.
- Essai de traction
,
essai de compression
,
essai de flexion
.
- Essai de resilience
,
Mouton Charpy
- Mesure de durete
- essais de viscosite (fluides), essais d'ecoulement (poudres, suspensions)
- essais de permeabilite (fluide a travers un milieu poreux, membrane)
- essais de fluage (deformations differees dans le temps sous sollicitation constante)
- essais de fissuration (propagation de fissures)
- essais de fatigue (rupture par des sollicitations repetees, sous l'influence de facteurs physico-chimiques)
- essais de crash test (vehicule lance contre un obstacle)
- essais de resistance aux seismes (batiments, ouvrages d'art)
- …
La methode experimentale est employee au sein de disciplines considerees comme des
sciences humaines
[
12
]
,
[
13
]
, telles que la
sociologie
, la
psychologie
, l'economie ou l'
archeologie
.
L'
experience de Milgram
est un exemple d'experience de
psychologie
realisee entre
1960
et
1963
par le
psychologue
americain
Stanley Milgram
. Cette experience cherchait a evaluer le degre d'
obeissance
d'un individu devant une autorite qu'il juge legitime et a analyser le processus de soumission a l'autorite, notamment quand elle induit des actions qui posent des problemes de
conscience
au sujet.
La methode experimentale est l'une des disciplines principales de l'emission
Sesame Street
, inauguree en 1969. C'etait le professeur Gerard S. Lesser de l'
universite Harvard
, en qualite de directeur de ses conseilleurs, qui a fait introduire cette methode scientifique. Cette derniere, devenue dite
methode Sesame Street
, contribue a obtenir un grand succes de l'emission jusqu'ici, en y assurant une production par excellence pour les enfants d'age prescolaire
[
14
]
.
- ↑
Chevreul Michel-Eugene,
Lettres adressees a M. Villemain sur la methode en general et sur la definition du mot "fait" : relativement aux sciences, aux lettres, aux beaux-arts, etc., etc.
, Paris, Garnier Freres, 1856,
p.
27-29
.
- ↑
Canguilhem 1968,
p.
153 et 166.
- ↑
Gayon 1996
- ↑
Canguilhem 1968
- ↑
1865,
p.
28.
- ↑
Claude Bernard,
Principes de medecine experimentale
, PUF, 1947, reed. Paris, PUF, 1987,
p.
77.
- ↑
Canguilhem 1968,
p.
233
- ↑
Pierre Duhem
, L’experience cruciale est impossible en physique, extrait de
La theorie physique, son objet et sa structure
, 1906, 1914, seconde partie, chapitre VI, § III.
[
lire en ligne
]
- ↑
Quine, ≪
Deux dogmes de l'empirisme
≫, in
De Vienne a Cambridge
, trad. P. Jacob, Gallimard, 1980.
- ↑
W. Kohler,
Gestalt Psychology
, 1929. Traduction francaise
La psychologie de la forme
, Gallimard, Paris, 1964. Traduit par Serge Bricianer.
[ref. incomplete]
- ↑
(en)
National Research Council (US) Committee on the Use of Third Party Toxicity Research with Human Research
Participants
,
Values and Limitations of Animal Toxicity Data
, National Academies Press (US),
(
lire en ligne
)
- ↑
Depelteau Francois,
La demarche d'une recherche en sciences humaines
, Bruxelles, De Boek, 2000, chapitre 5.2. La methode experimentale,
p.
251-271
.
- ↑
Giroux Sylvain, Tremblay Ginette,
Methodologie des sciences humaines : La recherche en action
, Editions ERPI, Saint-Laurent (QC), 2009,
p.
227.
- ↑
(en)
Liz Mineo, ≪
From Mass. Ave. to Sesame Street
≫,
The Harvard Gazett
,
(
lire en ligne
)
- Claude Bernard, 1865,
Introduction a l’etude de la medecine experimentale
, reed. Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
- Georges Canguilhem, 1968, Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin.
[
lire en ligne
]
- Georges
Roque
, ≪
La couleur reflechie
≫,
Etudes francaises
,
vol.
24,
n
o
2,
,
p.
53?68
(
DOI
10.7202/035752ar
)
- Jean Gayon, 1996, ≪ Les reflexions methodologiques de Claude Bernard : contexte et origines ≫,
Bull. Hist. Epistem. Sci. Vie
, 3 (1),
p.
75-92.
- Richard Linder, 2005,
Les plans d'experiences. Un outil indispensable a l'experimentateur
, Les Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 320 p. (
(
ISBN
2-85978-402-0
)
)
[
lire en ligne
]
- Roger Prat,
Experimentation en biologie et physiologie vegetales
,
Editions Quæ
,
(
lire en ligne
)
- Pierre Dagnelie, 2012,
Principes d'experimentation: planification des experiences et analyse de leurs resultats
,
Presses agronomiques
, Gembloux, 413 p.
(
ISBN
978-2-87016-117-3
)
et
edition electronique (PDF)
.
- Daniel Serra, 2022,
La "revolution" experimentale en economie. Une histoire des courants de recherche qui l'incarnent
, Presses Universitaires de la Mediterranee (PULM), 280 p.
(
ISBN
978-2-36781-476-6
)
- (en)
Philip Ball
,
Beautiful experiments. An illustrated history of experimental science
,
University of Chicago Press
,
, 240
p.
(
ISBN
978-0-226-82582-3
et
978-0-226-83026-1
,
DOI
10.7208/chicago/9780226830261.001.0001
)
- Ressource relative a la recherche
 :
:
Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes

:
|
|---|
|
| Paradigmes
|
|
 |
| Methodes utilisees
|
|
| Domaines d'investigation
|
|
| Domaines d'application
|
|
| Principaux concepts
|
|
| Figures de proue
|
|
|