 Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
 L'industriel
Emile-Justin Menier
, caricature par
Henri Demare
, 1875.
L'industriel
Emile-Justin Menier
, caricature par
Henri Demare
, 1875.
La
bourgeoisie
est une notion
historique
et
sociologique
. Le terme designe tout d'abord les habitants des
≪ bourgs ≫
mais en vient, a partir du
XIX
e
siecle
, et notamment du
marxisme
, a designer une
classe sociale
. Ainsi :
- En histoire :
- originellement et de facon generale, il s'agit de la qualite de
≪ ceux qui habitent le bourg ≫
, c'est-a-dire les gens de la ville (notamment marchands et
artisans
) par opposition a ceux de la campagne ; en ce sens, la bourgeoisie commence a se developper en Europe des le
XI
e
siecle et en particulier pendant la
Renaissance du
XII
e
siecle
;
- du
Moyen Age
a la fin de l'
Ancien Regime
, un statut juridique limite au cadre local
[
1
]
accorde par une ville a ses habitants qui combine des droits et des devoirs
[
2
]
(ce qu'en allemand on nomme
die Burger
et
das Burgertum
) ;
- En sociologie :
Derive de ≪ bourgeois ≫ (habitant du bourg), le vocable ≪ bourgeoisie ≫ est atteste des
1538
avec le sens d'≪ ensemble des habitants du bourg ≫ et en
937
sous la forme ≪
bourgesie
≫, correspondant au
latin
burgensia
, au sens
juridique
de citoyen ayant le
droit de cite
.
La ≪ bourgeoisie ≫, dans son sens premier, est donc intimement liee a l'existence des villes reconnues comme telles par leurs
chartes
urbaines ; il n'y avait donc pas de bourgeoisie ≪ hors les murs de la cite ≫ au-dela desquels les habitants etaient des ≪
manants
≫ soumis aux juridictions et aux corvees seigneuriales (a l'exception de la ≪
bourgeoisie foraine
≫ habitant hors du territoire urbain, mais y ayant conserve ses droits).
 Peinture de
Quentin Metsys
,
Le Preteur et sa femme
(1514).
Peinture de
Quentin Metsys
,
Le Preteur et sa femme
(1514).
 Illustration de
Narziss Renner
issue du
Livre des costumes
(1517).
Illustration de
Narziss Renner
issue du
Livre des costumes
(1517).
Les origines : la bourgeoisie urbaine medievale
[
modifier
|
modifier le code
]
C'est au
XI
e
siecle
qu'apparait la bourgeoisie. A l'origine, le terme de bourgeois designe l'habitant du bourg, et c'est donc le developpement des villes en Europe qui a permis le developpement de la bourgeoisie.
Or, les villes europeennes presentent au
Moyen Age
nombre de caracteristiques remarquables. Apres l'effondrement de l'Empire romain, et en meme temps que lui, de la structure urbaine sur laquelle il s'appuyait
[
5
]
, une renaissance urbaine se dessine a partir du
XI
e
siecle.
Des milliers de
villes
naissent alors, mais sont bien souvent organisees selon un modele encore campagnard, n'etant guere qu'un ≪ regroupement rural ≫, incluant dans leurs murs champs et jardins. Seules certaines d'entre elles vont reellement s'urbaniser, en mettant en place une nouvelle structure sociale ; elles jouent un role moteur evident, en Italie du nord, entre Loire et Rhin, et sur les cotes mediterraneennes ; elles voient se developper des corps de metiers, des marchands, une industrie, un commerce lointain qui leur permet de drainer des ressources, des banques. Deja se developpe une forme de bourgeoisie, et meme, de
capitalisme
[
6
]
.
Autour de ces villes privilegiees, l'Etat territorial s'affaiblit : si celui-ci renait en France, en Angleterre, en Espagne, en revanche, en Italie, dans les Flandres et en Allemagne, les villes sont bientot parfois suffisamment fortes pour se constituer en univers autonomes et s'affranchir de l'espace politique ancien, acquerant ou extorquant des privileges, se constituant ainsi un veritable rempart juridique
[
6
]
.
Ces villes, desormais sans entraves, innovent dans tous les domaines : sur le plan financier, avec les emprunts publics (le ponte Vecchio de Florence) et la
lettre de change
, la creation des premieres
societes commerciales
, sur le plan industriel, sur le plan commercial ou les echanges lointains se developpent. Les villes deviennent ≪ des petites patries de bourgeois ≫
[
7
]
, a Florence, a Venise, ou a Nuremberg. Une mentalite nouvelle se met en place, qui est le tout premier capitalisme d'Occident : a la difference du noble qui augmente les
impots seigneuriaux
pour ajuster ses revenus a ses depenses, le marchand calcule ses depenses selon ses revenus, et cherche a n'investir qu'a bon escient, en identifiant et en limitant les risques
[
8
]
.
En France, sous l'
Ancien Regime
, etre bourgeois d'une ville permettait de beneficier du statut juridique de la ville qui octroyait des droits et imposait des devoirs
[
2
]
, c'est-a-dire la citoyennete locale (droit de voter et d'etre elu a des emplois publics, obligations fiscales et de services gratuits dans la milice, la collecte des impots, les jurys,
etc.
).
Selon Felix Colmet Daage, a partir du
XV
e
siecle, aucun statut juridique particulier ne fut plus attache au titre de bourgeois, sauf s'il s'agissait d'artisans, de fabricants ou de marchands astreints au respect des reglements corporatifs de leur profession
[
9
]
. Toutefois, le statut de
bonne ville
ou les
privileges
royaux accordes a certaines villes donnaient a leurs bourgeois des privileges fiscaux et militaires, le droit de s'administrer, de se defendre, la haute justice, voir l'anoblissement pour leurs
echevins
,
consuls
ou
capitouls
. Ces privileges sont la continuation des chartes de franchise et de liberte medievales.
 Frontispice du
Bourgeois gentilhomme
(1682), de
Moliere
, œuvre qui temoigne de l'entree en politique des bourgeois, qui tentent d'imiter, et de se substituer, aux nobles.
Frontispice du
Bourgeois gentilhomme
(1682), de
Moliere
, œuvre qui temoigne de l'entree en politique des bourgeois, qui tentent d'imiter, et de se substituer, aux nobles.
La
monarchie
accordait et renouvelait les
privileges
accordes aux bourgeois des differentes villes par des
lettres patentes
[
1
]
. Le statut de ≪ Bourgeois de Paris ≫ donne les memes exonerations fiscales que la noblesse
[
10
]
,
[
11
]
.
Dans la reunion des
Etats generaux
, la bourgeoisie appartenait au
Tiers etat
[
12
]
: ≪ En 1791, le bourgeois est celui qui appartient au Tiers Etat tout en se distinguant de celui-ci par la puissance de certains privileges ≫
[
13
]
. La bourgeoisie qui n'appartenait ni au premier ordre (le
clerge
) ni au
second ordre
(la
noblesse
) mais au
tiers etat
, possedait pourtant des privileges qui la distinguait largement du peuple
[
14
]
: ≪ les bourgeois faisaient partie du Tiers etat des villes par opposition aux gentilshommes et aux ecclesiastiques ≫
[
15
]
.
La notion de bourgeoisie etait ≪ employee dans deux acceptions pour definir une partie du tiers etat urbain. L’une comprend la bourgeoisie au sens d’elite roturiere definie par des criteres de richesse et d'influence sociale (…). La bourgeoisie est cependant avant tout, sous l’
Ancien Regime
, un
statut juridique
donnant a certains
citadins
des droits distincts de ceux des autres habitants de la ville ≫
[
16
]
.
La distinction entre petite, grande et moyenne bourgeoisie est principalement d’ordre financier mais aussi liee a la notoriete et a l’exercice de la profession. Alors que la grande bourgeoisie (une fortune superieure, une situation plus ancienne, des emplois plus eleves dans la magistrature et la finance que la moyenne bourgeoisie)
[
17
]
regroupe l’elite du tiers etat sous l’Ancien Regime
[
18
]
, la place que l'Ancien Regime reserve a la petite bourgeoisie qui se trouve a la limite du tiers etat et du peuple (boutiquiers, artisans, fonctionnaires subalternes, paysans enrichis, etc.) n’a rien d’enviable car elle ne mene ni a la consideration ni a la fortune
[
19
]
.
≪ Dans cette societe d’ordres, les bourgeois qui avaient reussi ne pouvaient concretiser leur ascension sociale qu’en quittant la bourgeoisie et donc le
tiers etat
pour integrer le
deuxieme ordre
≫
[
20
]
par l'achat de charges anoblissantes.
Sous le regne du roi
Louis XIV
la bourgeoisie est presente au cœur de l'administration royale mais aussi dans de nombreux autres domaines
[
21
]
. Les historiens et sociologues modernes y voient une
bourgeoisie de robe
.
Dans les milieux intellectuels et artistiques qui frequentent les
salons litteraires
, il est courant de se moquer de la lourdeur d'esprit et du prosaisme du ≪ bourgeois ≫ insensible aux valeurs spirituelles : ainsi Chrysale dans
Les Femmes savantes
de
Moliere
se voit invectiver par son epouse qui pretend au bel esprit :
≪ Est-il de petits corps un plus lourd assemblage ! Un esprit compose d'atomes plus bourgeois ! ≫
; Monsieur Jourdain, dans
Le Bourgeois gentilhomme
, se rend ridicule en essayant d'imiter les ≪ gens de qualite ≫ sans avoir leur finesse de gout
[
22
]
.
 Maurice Duplay
,
revolutionnaire
jacobin
et bourgeois, gravure.
Maurice Duplay
,
revolutionnaire
jacobin
et bourgeois, gravure.
Plusieurs auteurs comme
Alexis de Tocqueville
(1805-1859) estiment que la bourgeoisie est a l'origine de la
Revolution francaise
. En effet, les bourgeois veulent une revolution politique afin que leur classe trouve sa place dans la
societe d'ordres
; par sa naissance, un bourgeois appartenait au
tiers etat
, toutefois certains par leur train de vie, voire leur fortune, pouvaient acheter des fiefs mais aussi des charges anoblissantes leur permettant acceder a la
noblesse
[
23
]
.
Cependant, le terme de ≪ bourgeoisie ≫ est peu employe par les auteurs et orateurs dans les premieres annees de la Revolution : ils lui preferent celui de
tiers etat
, de plus en plus identifie a la nation.
Robespierre
et les
sans-culottes
de
1793
ne tardent pas a denoncer une ≪ aristocratie bourgeoise ≫ ou ≪ bourgeoisie aristocratique ≫ de plus en plus consideree comme complice de la
contre-revolution
. Sous le
Directoire
, les interets des ≪ gens de bien ≫ attaches a l'ordre social s'opposent a ceux de la ≪ canaille ≫ revendicative, comme lors des
journees de germinal
et
prairial an III
, sans que cette difference soit theorisee
[
24
]
.
Sous
Napoleon
, la bourgeoisie, dont les couches superieures se confondent avec la
noblesse reconstituee
, fournit la plupart des cadres de l'Etat : le regime lui offre en echange la paix interieure, la garantie des richesses et la stabilite de la
monnaie
[
25
]
.
 Bourgeois a la
bourse de Paris
en 1850 par
Honore Daumier
.
Bourgeois a la
bourse de Paris
en 1850 par
Honore Daumier
.
La bourgeoisie comme corps social se constitue au cours du
XIX
e
siecle
, d'abord sous la
Restauration
(1815-1830) ou la noblesse tente une derniere fois de reprendre le pouvoir politique : l'opposition bourgeoise s'affirme lors de la
revolution de 1830
et triomphe sous la
monarchie de Juillet
(1830-1848). Neanmoins si elle est encore unie avec le monde ouvrier lors de la
revolution de Fevrier 1848
, la rupture intervient au moment des
Journees de Juin
. La bourgeoisie parisienne, suivie par celle des villes de province, s'unifie a travers les
grandes ecoles
, la
presse
et des interets economiques communs. La
Revolution industrielle
assure une
croissance economique
de 2 a 3 % par an, meme si le
transport ferroviaire
et la grande industrie ne se developpent qu'a partir du milieu du siecle
[
24
]
.
La bourgeoisie s'invente une tradition historique qu'elle fait remonter aux
communes medievales
. Si elle triomphe dans l'ordre social, elle est abondamment critiquee et moquee par les artistes, du
romantisme
au
realisme
[
26
]
.
Karl Marx
developpe l'idee de la
lutte des classes
comme moteur de l'histoire : la bourgeoisie, en triomphant de la noblesse, assure grace au
capitalisme
un essor economique et technique sans precedent mais exacerbe les
inegalites sociales
et engendre une nouvelle classe, le
proletariat
, qui finira par la detruire pour donner naissance au
socialisme
[
27
]
.
Au
XX
e
siecle, les modifications economiques tres importantes renouvellent les opportunites de creations d'entreprise et d'enrichissement. La bourgeoisie, et surtout la grande bourgeoisie, prend part au
capital economique
, au
capital social
, au
capital culturel
et au
capital symbolique
. Et lorsque cette concentration du pouvoir debouche sur l'exercice du
pouvoir politique
, le regime democratique peut etre affecte par : ≪ Le
Mur de l'argent
≫, ≪ les
deux cents familles
≫, les ≪ Tendances
ploutocratiques
≫…
Les bourgeois du
Moyen Age
devaient le plus souvent faire partie d'une
confrerie
(laique ou religieuse) ; il fallait etre libre de son seigneur depuis plus d'un an et demi au minimum et posseder une maison ou un hotel, etc. Une fois acquittes des nombreuses prerogatives d'entree, les bourgeois devaient faire la
chevauchee
souvent monnayable avec le seigneur en armure et a cheval, ou sinon, avec epee, et defendre les villes et les villages. Ils les administraient et avaient le pouvoir juridique et donc prenaient la decision de recevoir de nouveaux bourgeois qu'ils soient
serfs
, habitants ou
ducs
(comme le
duc de Savoie
devenu bourgeois de
Berne
en 1330), ou meme roi de France (comme
Louis XI
). En aucun cas les gueux,
etrangers
, marginaux ainsi que les
nomades
ne pouvaient acceder a la bourgeoisie.
Ils pouvaient porter des
armoiries
, participer aux
Croisades
, participer au financement des guerres, ou creer des entraides entre villes bourgeoises, les fameuses
Combourgeoisies
.
L'histoire de la bourgeoisie aux Etats-Unis differe de celle de la bourgeoisie europeenne par plusieurs aspects :
- son caractere recent, lie a l'histoire du pays lui-meme ;
- l'absence relative de la pesanteur sociologique dans l'histoire des Etats-Unis, en raison de sa nature de ≪ societe de pionniers ≫ ;
- la democratie et les regles economiques du pays, qui, des les premiers temps, favorisent la mobilite sociale
[
n 1
]
[ref. necessaire]
;
- l'importance primordiale, des les premiers temps egalement, de l'
emploi salarie
, soulignee par
Alexis de Tocqueville
.
 Bourse du riz de D?jima
,
ukiyo-e
par
Yoshimitsu Sasaki
.
Bourse du riz de D?jima
,
ukiyo-e
par
Yoshimitsu Sasaki
.
Les commercants ont jusqu'au debut du
XVII
e
siecle ete consideres au Japon comme tout a fait en bas de l'echelle sociale
[
28
]
: la societe japonaise traditionnelle comporte en effet, tout en haut de l'echelle, l'Empereur et l'aristocratie militaire des
daimy?
, puis les paysans (les plus nombreux), puis les artisans, et enfin, les marchands et les commercants, qui ne precedent guere que les
r?nin
, les acrobates ou les prostituees.
La naissance d'une bourgeoisie urbaine et marchande au
Japon
au tout debut du
XVII
e
siecle est due d'abord et avant tout a la periode de paix qui s'est alors instauree ; cette paix durable s'est traduite par la perte d'influence et de richesse de l'aristocratie militaire, et le developpement du commerce.
Obsede par le souci d'eviter a son pays les secousses et les guerres civiles que le Japon connait depuis quarante ans, guerres d'ailleurs precedees par la desagregation du pouvoir central au cours des siecles precedents, le
shogun
Tokugawa Ieyasu
, le nouveau maitre du Japon, engage, en 1603, le pays dans la longue periode d'immobilisme politique qui caracterise l'
ere Edo
.
 Pont de Nihonbashi a Edo,
courtiers en riz
.
Trente-six vues du mont Fuji
de
Hokusai
.
Pont de Nihonbashi a Edo,
courtiers en riz
.
Trente-six vues du mont Fuji
de
Hokusai
.
Sur le plan interieur, un probleme essentiel est de neutraliser la forte population de
samourais
, devenue inutile a la suite de la pacification du pays. Tokugawa Ieyasu s'appuie pour cela sur le systeme de ≪ residence alternee ≫, le
sankin-k?tai
, qui oblige les
daimy?
a passer une annee sur deux a T?ky?, en y laissant a demeure leur famille en otage. Cette double residence a non seulement l'avantage de donner un moyen de pression sur les
daimyo
au travers de cette prise d'otages, mais aussi celui de peser lourdement sur les finances personnelles de ceux-ci, obliges de se deplacer avec leur suite entre deux residences dont ils doivent assurer l'entretien
[
29
]
.
Simultanement, les marchands, qui occupaient jusque-la la position la plus basse dans la hierarchie sociale, s'assurent un role dominant dans la vie economique, des la fin du
XVII
e
siecle. Certains de ces marchands acquierent une fortune considerable, tels que la famille des
Mitsui
, qui fondera au
XX
e
siecle un empire economique, alors que dans le meme temps la caste militaire,
daimy?
et samourais, connaissent de graves difficultes financieres
[
30
]
.
Signe revelateur de cette evolution, certaines
estampes
editees a l'epoque peuvent en realite etre considerees comme des annonces publicitaires : ainsi,
Utamaro
en publie plusieurs series, telle que la serie de neuf estampes intitulee
Dans le gout des motifs d'Izugura
, realisees pour promouvoir de grande marques de magasins de textile (Matsuzakaya, Daimaru, Matsuya…), dont le
logo
apparait de facon ostensible ; certains de ces magasins existent encore de nos jours
[
31
]
.
L'existence de cette bourgeoisie marchande permettra ensuite le developpement d'une bourgeoisie plus large, a partir de l'
ere Meiji
, avec l'
ouverture du Japon au monde occidental
, a son commerce, a ses technologies et a sa science.
L'emergence d'une veritable bourgeoisie en Inde est un phenomene recent, largement rendue impossible pendant des siecles par l'existence d'
un systeme de castes
interdisant toute mobilite sociale.
Sans doute l'apparition d'une bourgeoisie significative est-elle liee a l'emergence de la societe industrielle et de l'economie de marche, ainsi qu'a une petite et moyenne bourgeoisie liee au developpement de l'Etat (hauts fonctionnaires, en particulier). La mondialisation actuelle, cassant les traditions sociales, et accelerant l'enrichissement de la population au-dela de tout ce que l'Inde avait auparavant connu, est un element fort de l'evolution actuelle de la bourgeoisie indienne.
La bourgeoisie pour Karl Marx (
XIX
e
siecle)
[
modifier
|
modifier le code
]
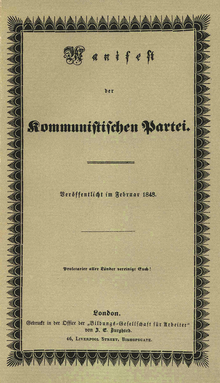 Couverture de la premiere edition du
Manifeste du parti communiste
.
Couverture de la premiere edition du
Manifeste du parti communiste
.
Karl Marx
caracterise le bourgeois du
Moyen Age
comme etant generalement un homme d'affaires independant - comme un
marchand
, un
banquier
ou un
entrepreneur
- dont le role economique dans la societe est d'etre l'intermediaire financier du proprietaire feodal et du paysan qui travaille le fief, la terre du seigneur. Pourtant, au
XVIII
e
siecle
, a l'epoque de la
revolution industrielle
(1750-1850) et du
capitalisme industriel
, la bourgeoisie devient progressivement la
classe dominante
sur l'economie, celle qui possede les
moyens de production
(
capital
et
terre
) et controle les
moyens de coercition
de l'
Etat
(
forces armees
,
justice
,
police
et
systeme penitentiaire
).
Dans une telle societe, la propriete de la bourgeoisie sur les moyens de production lui permet d'employer et d'exploiter la
classe ouvriere salariee
(urbaine et rurale), des personnes dont le seul moyen economique est le travail ; et le controle bourgeois des moyens de coercition supprime les contestations sociopolitiques des classes inferieures, et preserve ainsi le statu quo economique ; les travailleurs restent des travailleurs et les employeurs restent des employeurs
[
32
]
.
Au
XIX
e
siecle
,
Marx
distingue deux types de capitalistes bourgeois :
- les capitalistes fonctionnels, qui sont les administrateurs commerciaux des moyens de production ;
- les capitalistes rentiers dont les moyens de subsistance proviennent soit de la location de biens, soit des revenus d'interets produits par le capital financier, soit des deux
[
33
]
.
Au cours des relations economiques, la
classe ouvriere
et la bourgeoisie s'engagent continuellement dans la
lutte des classes
, ou les
capitalistes
exploitent les travailleurs, tandis que les travailleurs resistent a leur exploitation economique, qui se produit parce que le travailleur ne possede aucun moyen de production et, pour gagner un revenu suffisant a sa subsistance, cherche un emploi aupres du capitaliste bourgeois ; le travailleur produit des biens et des services qui sont la propriete de l'employeur, qui les revend moyennant un certain prix plus eleve que celui auquel il paie le travailleur ; ce qui lui permet de s'enrichir par la
plus-value
, et donc, par un
systeme parasitaire
sur les productions du travailleur.
En plus de decrire la classe sociale qui possede les moyens de production, l'utilisation
marxiste
du terme ≪ bourgeois ≫ decrit egalement le style de vie consumeriste derive de la propriete du capital et des biens immobiliers. Marx reconnait l'assiduite bourgeoise qui creait la richesse, mais critique l'hypocrisie morale de la bourgeoisie lorsqu'elle ignore les pretendues origines de sa richesse : l'exploitation du proletariat, des travailleurs urbains et ruraux.
Ainsi, la
theorie marxiste
considere la bourgeoisie comme la
classe sociale
s'opposant le plus fondamentalement au
proletariat
, dans la mesure ou les ouvriers attendent que leurs
salaires
soient les plus eleves possibles alors que les
proprietaires
entendent augmenter leurs
profits
en employant la
main-d'œuvre
au cout le plus bas possible. De cette difference de fait nait le concept marxiste de
lutte des classes
, le but de toute
revolution
etant d'abolir les disparites et de reduire notamment les
inegalites
de revenus.
En 1848, dans leur
Manifeste du Parti communiste
,
Karl Marx
et
Friedrich Engels
definissent la bourgeoisie dans l'histoire comme la classe revolutionnaire par excellence, une classe dominante qui a ses propres valeurs et qui les a imposees au monde pour evincer du pouvoir les autres classes :
≪ La bourgeoisie a joue dans l'histoire un role eminemment revolutionnaire. Partout ou elle a conquis le pouvoir, elle a detruit les relations feodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens varies qui unissent l'homme feodal a ses superieurs naturels, elle les a brises sans pitie pour ne laisser subsister d'autre lien, entre l'homme et l'homme, que le froid interet, les dures exigences du ≪ paiement au comptant ≫. Elle a noye les frissons sacres de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalite petite-bourgeoise dans les eaux glacees du calcul egoiste. En un mot, a l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a substitue une exploitation ouverte, ehontee, directe, brutale. La bourgeoisie a depouille de leur aureole toutes les activites considerees jusqu'alors, avec un saint respect, comme venerables. Le medecin, le juriste, le pretre, le poete, l'homme de science, elle en a fait des salaries a ses gages. La bourgeoisie a dechire le voile de sentimentalite touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les a reduits a de simples rapports d'argent. C'est elle qui, la premiere, a fait la preuve de ce dont est capable l'activite humaine : elle a cree de tout autres merveilles que les pyramides d'Egypte, les aqueducs romains, les cathedrales gothiques ; elle a mene a bien de tout autres expeditions que les invasions et les croisades.
La bourgeoisie ne peut exister sans revolutionner constamment les instruments de production et donc les rapports de production, c'est-a-dire l'ensemble des rapports sociaux.
Tous les rapports sociaux stables et figes, avec leur cortege de conceptions et d'idees traditionnelles et venerables, se dissolvent ; les rapports nouvellement etablis vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout element de hierarchie sociale et de stabilite d'une caste s'en va en fumee, tout ce qui etait sacre est profane, et les hommes sont enfin forces d'envisager leur situation sociale. Leurs relations mutuelles d'un regard lucide
[
34
]
. ≫
Pour Marx, les revolutions anglaises et francaises ne sont que des revolutions bourgeoises, faites par la bourgeoisie pour se porter au pouvoir.
[ref. necessaire]
La bourgeoisie pour Friedrich Engels (
XIX
e
siecle)
[
modifier
|
modifier le code
]
Friedrich Engels
definit ainsi la bourgeoisie du point de vue economique :
≪ Par bourgeoisie, on entend la classe des
capitalistes
modernes, qui possedent les moyens de la production sociale et emploient du travail salarie ; par proletariat, la classe des travailleurs salaries modernes qui, ne possedant pas en propre leurs moyens de production, sont reduits a vendre leur force de travail pour vivre
[
35
]
. ≫
La bourgeoisie selon Jacques Ellul (
XX
e
siecle)
[
modifier
|
modifier le code
]
 Ellul (deuxieme a droite sur la photo) recoit son
doctorat
honoris causa
de l'
universite libre d'Amsterdam
le
, en meme temps que
Martin Luther King
(au centre).
Ellul (deuxieme a droite sur la photo) recoit son
doctorat
honoris causa
de l'
universite libre d'Amsterdam
le
, en meme temps que
Martin Luther King
(au centre).
En 1967, dans son ouvrage
Metamorphose du Bourgeois
,
Jacques Ellul
souscrit aux theories de Marx qui soutiennent que la bourgeoisie constitue une classe sociale dominante. Mais il considere que la bourgeoisie du
XX
e
siecle differe fondamentalement de celle du
XIX
e
siecle : elle s'est ≪ metamorphosee ≫, elle n'est plus mondaine et repliee sur elle-meme car, de par sa capacite a assimiler toutes sortes de
valeurs
, y compris celles qui lui sont hostiles, non seulement les
milieux populaires
ne la contestent plus mais ils se sont eux-memes ≪ embourgeoises ≫. Si l'on peut encore parler de
classes sociales
, affirme Ellul, le concept de ≪
lutte des classes
≫ est revolu du fait que ≪ l’elevation du
pouvoir d’achat
≫ et ≪ la recherche du
confort
materiel maximal ≫ constituent des objectifs qui non seulement sont communs a toutes les classes mais desamorcent definitivement toute velleite de conflit. Mais ce n'est pas la l'originalite premiere de l'analyse ellulienne. Ellul considere en effet que ≪ le Bourgeois ≫ est devenu gestionnaire et que ≪ le Technicien ≫ est devenu en quelque sorte son heritier.
≪ Le Technicien a recueilli les caracteres essentiels de tout ce que le bourgeois a cree (…). Mais, a la difference du bourgeois, il peut etre tout d’une piece, il n’est plus divise. Il n’est plus un etre trouble. Il n’est plus enracine dans aucun passe. Il n’est plus tire en arriere. Il n’est jamais
reactionnaire
. (…) Il a integre dans le Tout de sa vie la valeur du
progres
. Et, sans en savoir rien, il est libere de tout scrupule, de tout dechirement par les bulldozers de l’epoque bourgeoise, tels
Marx
ou
Freud
. Il peut enfin etre lui-meme, tout simplement, ce que le bourgeois n’a jamais pu tout a fait accomplir. Il n’eprouve plus aucune des
contradictions
de la conscience bourgeoise, il sait maintenant clairement ce qu’il a a faire, il ne se laisse encombrer ni par des sentiments ni par des jugements moraux
[
36
]
. ≫
Critiques et nuances de la vision marxiste
[
modifier
|
modifier le code
]
L'
historiographie
influencee par le
marxisme
ou par les mouvements aristocratiques
contre-revolutionnaires
considere la bourgeoisie comme a l'origine de l'
individualisme
liberal, de la valeur travail, du
capitalisme
, mais aussi a l'origine de la
libre conscience
, de la
democratie liberale
et des regimes d'opinion ou des
revolutions francaise
et
americaine
[ref. necessaire]
. Mais l'historiographie recente montre plutot l'extreme diversite de sa classification et de son ideologie
[
37
]
.
Dans son ouvrage
Les responsabilites des dynasties bourgeoises
[
38
]
, le
journaliste
d'
extreme-droite
Emmanuel Beau de Lomenie
tente de demontrer qu'un petit nombre de dynasties bourgeoises controleraient la
France
a partir de la
Revolution francaise
.
- Tome 1 :
De
Bonaparte
a
Mac Mahon
. Selon
Beau de Lomenie
, le premier noyau des dynasties bourgeoises (les fameuses futures ≪
Deux cents familles
≫) est compose de personnages issus des milieux de
justice
et de
basoche
, qui doivent leurs cyniques enrichissements a la
Revolution de 1789
. Pour eviter la restauration monarchique qui les menace, ces ancetres des grands capitalistes vont faire appel a un militaire ambitieux et glorieux mais encore sans attache politique : Bonaparte. Devenu Napoleon
I
er
, celui-ci sera prisonnier de ces cadres… et bientot trahi par eux. Par la suite, ces ≪ profiteurs ≫ joueront des ideologies les plus diverses pour se maintenir en place et devenir les maitres de l'industrie et de la finance.
- Tome 2 :
De
Mac Mahon
a
Poincare
. Ou sont etudiees sous un jour nouveau les crises boulangistes, de l'Affaire Dreyfus, du Combisme. Sont evoquees egalement les influences qui, selon l'auteur, constituent les ressorts de certaines affaires : comment le plan de grands travaux de
Freycinet
, impose par les dirigeants des chemins de fer, ouvrit des les debuts, la voie des deficits budgetaires ; comment le ministere de
Gambetta
fut torpille par les Compagnies ; comment les carrieres des politiciens en vedette furent le paiement de services rendus aux memes compagnies ; comment la haute banque poussa a la fondation de l'empire colonial pour s'y assurer le monopole de concessions abusives ; comment enfin les accords conclus au Maroc entre la finance francaise et la finance allemande preparerent la guerre de 1914.
- Tome 3 :
Sous la
Troisieme republique
: La guerre et l'immediat apres-guerre
.
- Tome 4 :
Du
Cartel des gauches
a
Hitler
. Soit la periode qui va de 1924 a 1933 qui fut -selon
Emmanuel Beau de Lomenie
- une epoque de grandes folies financieres et diplomatiques. Les crises economiques qui se succedent alors devaient engendrer des revoltes qui furent a l'origine de la Seconde Guerre mondiale.
Marthe Hanau
,
Oustric
, et autres furent les heros de ces temps ou l'inflation etait consideree comme le seul remede aux maux economiques.
- Tome 5 :
De
Hitler
a
Petain
.
Critiques et nuances des theories d'Emmanuel Beau de Lomenie
[
modifier
|
modifier le code
]
Beau de Lomenie vise a exposer une pretendue influence demesuree
[
n 2
]
d'un petit nombre de
≪ dynasties bourgeoises ≫
immuables. Plusieurs historiens (
Jean-Noel Jeanneney
,
Jean-Pierre Rioux
, Sylvain Schirmann, Philippe Hamman...) soulignent que son systeme se rattache a une
theorie du complot
dont la popularite transcende les frontieres politiques malgre les vues d'extreme droite de l'auteur.
Ainsi, dans son etude sur le grand commerce francais entre 1925 et 1948, l'historienne Laurence Badel precise qu'il se pose
≪ dans le champ d'etude des milieux d'affaires, le delicat probleme de la place des
groupes de pression
dans la societe francaise. En depit des reflexions conduites dans ce domaine, une suspicion entache toujours l'existence et l'action de ces groupes et a contamine la vision historique que l'on peut avoir de certaines questions. S'interesser aux groupes, c'est s'exposer a etre accuse de vehiculer une vision du monde reposant sur le complot et les groupes occultes a la maniere d'un Beau de Lomenie. Sans eluder l'importance des strategies matrimoniales, des connivences mondaines et des solidarites d'institutions, il est possible de dresser une histoire ≪ noble ≫ des milieux d'affaires et de leur organisation a des moments determines pour promouvoir le succes d'une cause
[
40
]
. ≫
Rendant compte de l'ouvrage
La mort de la troisieme Republique
(Editions du Conquistador, 1951), le
politologue
Francois Goguel
souligne ≪ la fantaisie des methodes de travail ≫ de Beau de Lomenie eu egard a ses nombreux ≪ exemples d'affirmations aussi purement gratuites ou notoirement inexactes ≫, qu'il s'agisse de confusions commises entre differentes personnes ou de soi-disant revelations sans mention de source. Goguel conclut que ≪ le propos ≫ de Beau de Lomenie ≪ n'est pas l'exactitude du detail, c'est l'expose d'une these. Il est trop profondement convaincu pour admettre que les faiblesses de sa documentation de base puissent infirmer ses conclusions. En realite, quoi qu'il en pense, M. de Lomenie n'est pas le moins du monde historien, mais bien pamphletaire et memorialiste
[
41
]
. ≫
Classification de la bourgeoisie chez les Francais
[
modifier
|
modifier le code
]
En France, il existe traditionnellement diverses strates au sein de la bourgeoisie.
 Manuel de la
Cuisiniere bourgeoise
, 1885
(cliquer pour feuilleter)
.
Manuel de la
Cuisiniere bourgeoise
, 1885
(cliquer pour feuilleter)
.
Bourgeoisie d'une ou deux generations s'etant formee par une breve ascension sociale. Elle debute generalement par le commerce de details ou l'artisanat, puis au fil de la deuxieme puis troisieme generation, elle peut s’elever socialement a un niveau de moyenne bourgeoisie. Cette classe tend a se confondre avec la classe moyenne de la societe et se distingue surtout par sa mentalite
[pas clair]
.
La
petite bourgeoisie
(artisans, petits commercants, boutiquiers, petits agriculteurs proprietaires, etc.) se distingue du proletariat par la petite propriete et surtout par la mentalite
[ref. necessaire]
.
Elle dispose de patrimoines ou de revenus solides mais n'a pas l'aura de la grande bourgeoisie. Elle serait selon certains une bourgeoisie de la troisieme generation. Elle possede parfois quelques alliances avec d’autres familles issues du meme milieu et parfois meme anciennes. Elle se distingue surtout par ses metiers : avocat, medecin, architecte, etc., avec des revenus inferieurs a ceux de la grande bourgeoisie. Les membres de la moyenne bourgeoisie sont generalement des cadres superieurs
[ref. necessaire]
.
A la fin de l'Ancien Regime, certaines de ces familles auraient pu pretendre acceder a la noblesse si elles avaient su continuer a progresser socialement ou si les circonstances politiques le leur avaient permis. Apres la guerre de 1914-1918 la sociologie de ces familles change avec la naissance de la societe capitaliste moderne. Durant la premiere moitie du
XX
e
siecle, la haute bourgeoisie est alors symbolisee par les ≪
deux cents familles
≫.
Cette classe sociale est tres souvent endogame
[ref. necessaire]
, et frequente les
rallyes
, organisations mondaines ou l'on se coopte.
Son patrimoine culturel, historique et financier reste aujourd'hui important. Dans la societe francaise actuelle,
Michel Pincon
et
Monique Pincon-Charlot
, dans un ouvrage intitule
Les Ghettos du gotha
, ont etudie la permanence et les mutations de cette classe et en particulier sa maniere de se proteger des classes jugees inferieures et de ce que l'on appelle les ≪
nouveaux riches
≫.
Rene Remond
definit l'ancienne bourgeoisie comme etant :
≪ Un groupe intermediaire entre la noblesse d'origine et ce qu'on appellerait les classes moyennes, qui est constitue au
XV
e
siecle
ou au
XVI
e
siecle
. (…) Ces familles sont presque toutes des dynasties provinciales dont l'ascension s'est tout entiere accomplie dans leur region d'origine a laquelle elles sont generalement restees fideles : aujourd'hui encore leurs descendants y sont presents. (…) Ces familles plongent leurs racines dans l'
Ancien Regime
. (…) Elles ont su assurer sur quatre ou cinq cents ans la transmission de leur heritage materiel comme de leur patrimoine de conviction et de valeur. ≫
?
Rene Remond
[
42
]
Pour
Xavier de Montclos
[
42
]
, ces familles ont accede a la bourgeoisie sous l'
Ancien Regime
, elles appartenaient a la notabilite des villes et des bourgs.
Elles acquierent des
offices administratifs
et judiciaires ou des charges importantes, puis se distinguent par une reussite toute particuliere dans le negoce et l'industrie. Certaines de ces familles ont ete anoblies.
Le terme de ≪
Haute societe protestante
≫ (HSP) designe une puissante
minorite protestante
, descendante des
huguenots
. Volontiers discrete, elle dispose neanmoins d'un solide pouvoir financier (
banques
et
institutions financieres
) et beneficie d'une influence politique et sociale non negligeable dans la societe francaise.
Cette classification toute descriptive et statique s'appuie sur l'idee que la bourgeoisie est d'abord et avant tout hereditaire, et que l'on en grimpe les echelons par l'accumulation quasi-mecanique du patrimoine au fil des generations. Elle ne rend donc pas compte de l'emergence soudaine, et frequente, de reussites individuelles qui placent d'emblee la personne concernee dans la ≪ haute bourgeoisie ≫. Or la mobilite sociale d'une generation a l'autre est certainement une des caracteristiques fondamentales de la bourgeoisie par rapport a la noblesse, aux Etats-Unis, bien sur, mais aussi en France, en Europe, au Japon, ou meme dans l'Inde ou la Chine d'aujourd'hui.
- ↑
Note : Meme si
des etudes
[Lesquelles ?]
ont montre que le ≪ reve americain ≫ ne permettait pas plus de mobilite sociale, de nos jours, que le systeme francais, ou les systemes scandinaves,
il a permis une grande mobilite sociale dans les siecles precedents, ou la pesanteur sociologique etait plus forte en Europe
[ref. necessaire]
- ↑
≪ Tous les travaux cites […] ont eu pour premier bienfait, il va sans dire, de rompre avec l'atmosphere de suspicion systematique qui entourait toute observation du patronat au temps des ≪ 200 familles ≫ et qu'ont alors ≪ illustree ≫ les livres d'E. Beau de Lomenie et d'
A. Hamon
[
39
]
. ≫
- ↑
a
et
b
Claude Gauvard, Jean-Louis Robert,
Etre parisien
, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 70.
- ↑
a
et
b
Yves Junot,
"c'est+se+prevaloir+d'un+statut+juridique+defini+parla+ville,+qui+combine+droits+et+devoirs+et+qui+marque+l'appartenance+de+l'individu+a+une+communaute"&hl=fr
Les bourgeois de Valenciennes: Anatomie d'une elite dans la ville (1500-1630)
, Presses univ. Septentrion, 2009, p. 33.
- ↑
(Robert,
Dictionnaire historique de la
langue francaise
)
- ↑
(Zangarelli,
Dictionnaire de la langue italienne
, Zanichelli ed.)
- ↑
Braudel 1979
,
p.
449.
- ↑
a
et
b
Braudel 1979
,
p.
450.
- ↑
Braudel 1979
,
p.
451.
- ↑
Braudel 1979
,
p.
452.
- ↑
Felix Colmet Daage,
La classe bourgeoise
, Nouvelles Editions Latines, 1959, p. 19.
- ↑
Laurence Croq,
Les bourgeois de Paris au
XVIII
e
siecle : identification d'une categorie sociale polymorphe
, Presses universitaires du Septentrion, 1999, p. 300.
- ↑
Etre parisien: actes du colloque organise par l’Ecole doctorale d'histoire
, universite Paris I Pantheon-Sorbonne et la Federation des Societes historiques et archeologiques de Paris-Ile-de-France, 26-28 septembre 2002, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 70.
- ↑
Dictionnaire politique; encyclopedie du langage et de la sciences politiques, redige par une reunion de deputes, de publicistes et de journalistes, avec une introduction par Garnier-Pages
, Pagnerre, 1842, p. 165 : ≪ Le tiers-etat, c'est, en effet, la Bourgeoisie jusqu'en 89. ≫
- ↑
Beatrix le Wita,
Ni vue ni connue: Approche ethnographique de la culture bourgeoise
, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 11 dec. 2015, p. 36.
- ↑
Benoit Garnot,
Societe, cultures et genres de vie dans la France moderne - Edition 1991:
XVI
e
???
XVIII
e
siecle
, Hachette Education, 1 avr. 2014, p. 2.
- ↑
Roland Mousnier
,
Les institutions de la France sous la monarchie absolue
, PUF, 1985, p. 188.
- ↑
Anne Conchon, Isabelle Paresys, Bruno Maes, sous la direction de Robert Muchembled,
Dictionnaire de l'Ancien Regime
,
Dictionnaire de l'Ancien Regime
, Armand Colin, 2004.
- ↑
Vicomte Herve de Broc,
La France sous l'ancien regime
, Volume 1, E. Plon, Nourrit et cie, 1887, p. 378.
- ↑
Laurent Coste
Les bourgeoisies en France: Du
XVI
e
au milieu du
XIX
e
siecle
, Armand Colin, 21 aout 2013
- ↑
Jean V. Alter,
Les Origines de la satire antibourgeoise en France
, Librairie Droz, 1970, p. 29.
- ↑
Laurent Coste,
Les bourgeoisies en France: Du
XVI
e
au milieu du
XIX
e
siecle
, Armand Colin, 2013.
- ↑
Article sur Universalis.fr
Bourgeoisie francaise
.
- ↑
Jean V. Alter,
Les Origines de la satire antibourgeoise en France
, Librairie Droz, 1970, p. 98.
- ↑
Alexis de Tocqueville,
L'Ancien Regime et la Revolution
- ↑
a
et
b
Sarah Maza, ≪
Construire et deconstruire la bourgeoisie : discours politique et imaginaire social au debut du
XIX
e
siecle
≫,
Revue d’histoire du
XIX
e
siecle
,
vol.
1,
n
o
34,
,
p.
21-37
(
lire en ligne
)
.
- ↑
Claude Thelot, ≪ Reexamen de la mobilite sociale sous le Premier Empire ≫, Napoleonica. La Revue, 2020/3 (
n
o
38), p. 7-161
[1]
- ↑
Jean Delabroy,
Parlez-moi de bourgeoisie (A propos de l'article "Bourgeois, Bourgeoisie" du "Dictionnaire de la Conversation", 2e edition, 1861)
, Romantisme, 1977,
n
o
17-18. Le bourgeois.
p.
7-227
.
- ↑
Rene Gallissot,
Marx des historiens, Marx des philosophes, Marx des economistes
.
In
L'Homme et la societe
,
n
o
67-68, 1983. Repression emprise violence.
p.
203-209
.
- ↑
Edwin O. Reischauer,
Histoire du Japon et des Japonais
, Editions du Seuil, 1973, tome 1, page 110
- ↑
Edwin O. Reischauer,
Histoire du Japon et des Japonais
, Editions du Seuil, 1973, tome 1, p. 103
- ↑
Edwin O. Reischauer,
Histoire du Japon et des Japonais
, Editions du Seuil, 1973, Tome 1, p. 119-128.
- ↑
Gisele Lambert et Jocelyn Bouquillard,
Estampes japonaises, Images d'un monde ephemere
, BnF, 2008, p. 128.
- ↑
Karl Marx
,
The Class Struggles in France, 1848 to 1850
, 1850
- ↑
T.B. Bottomore,
A Dictionary of Marxist Thought
, p. 272
- ↑
Manifeste du Parti communiste
- ↑
Note d'Engels pour l'edition anglaise en 1888.
- ↑
Jacques Ellul,
Metamorphose du Bourgeois
.
2
e
edition, La table ronde, 1998,
p.
222-224
.
- ↑
Laurent Coste,
Les bourgeoisies en France : du
XVI
e
au milieu du
XIX
e
siecle
,
Armand Colin
,
, 272
p.
- ↑
Cinq tomes rediges de 1943 a 1965 et publies de 1943 a 1973 chez Denoel; reedites en 1978 par les Editions du Trident
- ↑
Jean-Pierre
Rioux
, ≪
Les elites en France au
XX
e
siecle. Remarques historiographiques
≫,
Melanges de l'Ecole francaise de Rome. Moyen Age, Temps modernes
,
t.
95,
,
p.
13-27
(
lire en ligne
)
.
- ↑
Laurence
Badel
(
pref.
Rene Girault
),
Un milieu liberal et europeen : le grand commerce francais, 1925-1948
, Paris, Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie, Comite pour l'histoire economique et financiere de la France,
coll.
≪ Histoire economique et financiere de la France / Etudes generales ≫,
,
XVIII
-576
p.
(
ISBN
2-11-090083-0
,
lire en ligne
)
, ≪ Introduction ≫
.
- ↑
Francois Goguel, ≪ Beau de Lomenie (E.) -
La mort de la troisieme Republique
≫,
Revue francaise de science politique
, volume II,
n
o
2, avril-juin 1952, Paris,
Presses universitaires de France
, p. 413-414,
lire en ligne
.
- ↑
a
et
b
Xavier de Montclos (
pref.
Rene Remond
),
L'ancienne bourgeoisie en France du
XVI
e
au
XX
e
siecle
,
, 358
p.
(
ISBN
978-2-86496-135-2
,
lire en ligne
)
.
Sur les autres projets Wikimedia :
- Fernand
Braudel
,
Civilisation materielle, Economie et Capitalisme :
XV
e
???
XVII
e
siecle
,
t.
1 :
Les Structures du quotidien
,
Armand Colin
,
- Edmond Goblot
,
La Barriere et le niveau. Etude de sociologue de la bourgeoisie francaise moderne
,
Felix Alcan
,
- Regine Pernoud
,
Histoire de la Bourgeoisie en France
,
t.
2 :
Les temps modernes
,
Le Seuil
,
Ce livre, dont l'auteur est chartiste, rassemble une documentation et une bibliographie considerable afin de decrire la formation, la nature et le role de la bourgeoisie en France. Dans ce bilan historique, Regine Pernoud a constamment cherche a degager les tendances dominantes et determinantes de la constitution d'une culture bourgeoise, et a les confronter aux etudes philosophiques et sociologiques existantes a l'epoque.
- Jacques Ellul
,
Metamorphose du bourgeois
,
Editions de la Table Ronde
,
(
1
re
ed.
1967
)
- Jacques Heers
,
Le Clan familial au Moyen Age
,
PUF
,
- Monique Pincon-Charlot
et
Michel Pincon
,
Sociologie de la bourgeoisie
,
La Decouverte
,
coll.
≪ Reperes ≫,
(
presentation en ligne
)
- Michel Pincon et Monique Pincon-Charlot,
Voyage en grande bourgeoisie
- Michel Pincon et Monique Pincon-Charlot,
Balade chez les grands bourgeois
- Michel Pincon et Monique Pincon-Charlot,
Les ghettos du Gotha
- Suzanne de Brunhoff,
Bourgeoisie : etat d'une classe dominante
,
Editions Syllepse
,
- Marc Fumaroli
(presidence),
Gabriel de Broglie
(presidence) et
Jean-Pierre Chaline
(
dir.
),
Fondation Singer-Polignac
,
Elites et sociabilite en France : actes du colloque, Paris, le 22 janvier 2003
(conference),
Perrin
,
- Michel Popoff
,
Prosopographie
des gens du
parlement de Paris
(1266-1753) D'apres les manuscrits Fr. 7553, 7554, 7555, 7555 bis conserves au Cabinet des manuscrits de la
Bibliotheque nationale de France
, References
Saint-Nazaire
,
- Simone Roux,
Les racines de la bourgeoisie
, Editions Sulliver,
- Werner Sombart,
Le bourgeois. Contribution a l’histoire morale et intellectuelle de l’homme economique moderne
,
Payot
1926, traduit de l'Allemand.
En reedition
- Olivier Borgeaud,
La bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au xixe siecle
, Besancon, Presses universitaires de Franche-Comte,
coll.
≪ Annales litteraires ≫,
, 380
p.
(
ISBN
978-2-84867-985-3
,
DOI
10.4000/books.pufc.51708
,
lire en ligne
)
.
Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes

: